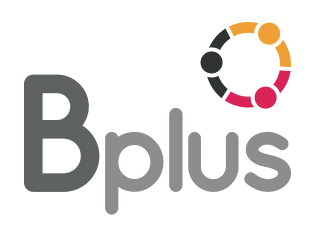Il a été décidé d'abolir définitivement le Sénat de Belgique, après lui avoir d’abord retiré pratiquement toutes ses compétences. Il s’agit pourtant de l’un des fondements sur lesquels la démocratie dans le Royaume de Belgique a été établie, et qui, pendant plus d’un siècle et demi, a, de l’avis général, toujours accompli un travail très utile en tant que chambre de réflexion.

La Belgique n’est pas le seul pays où l’on a estimé que le pouvoir législatif devait s’organiser un système propre de contrôle, afin que des lois, parfois adoptées dans une atmosphère un peu précipitée ou surchauffée, puissent encore être examinées posément avant d’entrer en vigueur. Les exemples d’autres pays ne manquent pas. En Europe, il s’agit des Pays-Bas (Eerste Kamer), de l’Allemagne (Bundesrat), de la France (Sénat), du Royaume-Uni (House of Lords), de l’Irlande (Seanad), de l’Espagne (Cortes Generales), de l’Italie (Senato), de la Suisse (Conseil des États), de la Pologne (Chambre haute), de l’Autriche (Bundesrat), de la Roumanie (Sénat).
Sur le continent américain, on retrouve une deuxième chambre législative notamment aux États-Unis (Sénat), au Canada (Sénat), en Argentine (Sénat), en Colombie (Sénat), au Brésil (Sénat), en Bolivie (Cámara de senadores), au Mexique (Sénat), au Paraguay (Cámara de senadores), en Uruguay (Cámara de senadores).
En poursuivant encore la recherche, on trouve une seconde chambre notamment dans des pays démocratiques comme l’Inde (Conseil des États), le Japon (Chambre haute), l’Australie (Sénat), les Philippines (Sénat).
Il existe bien sûr aussi des pays qui jugent suffisant de n’avoir qu’une seule assemblée législative. En Europe, il s’agit principalement des pays scandinaves, des États baltes et du grand-duché de Luxembourg. Ce sont des États géographiquement petits, avec une population relativement réduite et une structure étatique simple. Les seuls États fédéraux qui sont monocaméraux sont le Venezuela, la Micronésie, les Comores et Saint-Christophe-et-Niévès (dans les Caraïbes). Le premier est gangrené par la corruption, les autres sont de petits États insulaires. La Belgique veut-elle se ranger dans cette catégorie ?
Il n’existe aucune grande ou moyenne démocratie à signaler, et à l’exception des cas précités, absolument aucun État fédéral, qui n’ait jugé prudent de créer un organe législatif bicaméral, où une chambre contrôle et améliore l’autre.
Contrairement à tous ces pays, on croit savoir mieux en Belgique et on veut abolir le Sénat. Pour faire accepter cela à l’opinion, on a d’abord commencé par supprimer méthodiquement pratiquement toutes les compétences du Sénat, pour pouvoir ensuite dire : « Vous voyez bien que cette institution est superflue ! » Il se passe la même chose avec les provinces, auxquelles on a retiré leurs principales compétences (culture et sport), pour là aussi pouvoir avancer l’argument de l’inutilité en faveur de la suppression. Dans les deux cas, on a clairement pu soupçonner derrière cela l’idée d’un éclatement de la Belgique. Puisque la grande majorité considère désormais que cela n’est ni nécessaire ni souhaitable, il est temps de reconsidérer les décisions politiques prises autrefois dans le cadre de la fédéralisation.
Depuis que la Belgique est devenue un État fédéral, elle possède six parlements. Chacune de ces institutions légifère de son côté. Même si elles le font de bonne foi et avec compétence, elles produisent régulièrement des lois et décrets mal réfléchis et contradictoires, qui ne facilitent pas la gestion et la sécurité juridique, ni pour l’autorité, ni a fortiori pour le citoyen. C’est dans cette perspective, reconnue comme un problème par pratiquement tous les États fédéraux, qu’une chambre de réflexion est jugée nécessaire et indispensable.
Un homme d’État sage et expérimenté comme Leo Tindemans s’est exprimé dans ses Mémoires de manière critique sur l’abolition prévue du Sénat. Une fois celle-ci accomplie, jugeait-il, le législateur fédéral dans cette Belgique compliquée dépendra d’une assemblée nerveuse et querelleuse, une sorte de café de la « législation expéditive », où de mauvais textes juridiques seront expédiés à la hâte. Et il ne parlait même pas encore du fait que six parlements fonctionnant côte à côte ont besoin d’un organe de coordination sérieux.
D’autres voix se sont fait entendre, surtout au sein de la démocratie chrétienne flamande et francophone, qui ont souligné que le Sénat, presque totalement dépouillé, conserve malgré tout un rôle dans les nominations au Conseil d’État, au Conseil supérieur de la Justice et à la Cour constitutionnelle. Cette compétence, exercée par les sénateurs désignés par les parlements régionaux, disparaîtrait avec la suppression du Sénat. On a également signalé la compétence du Sénat d’envoyer des délégués belges aux réunions interparlementaires, telles que l’OTAN et le Conseil de l’Europe. Ces compétences seraient inévitablement transférées à la Chambre des représentants, et les régions ne pourraient donc plus s’exprimer sur la scène internationale. C’est un aspect secondaire, mais non négligeable.
Le choix inconsidéré qui a été fait d’abolir le Sénat belge est-il irréversible ? On peut espérer que non. Beaucoup de choses ont évolué depuis que cette décision a été prise, et de meilleures perspectives ont pu être acquises. Le Constituant eut jadis la sagesse d’ancrer le Sénat dans la Constitution. On peut donc espérer que la majorité des deux tiers, nécessaire pour l’abolition, ne sera pas atteinte, que celle-ci deviendra ainsi impossible et qu’au contraire le bon sens prévaudra et que le Sénat pourra être rétabli dans ses pleines compétences d’autrefois.
Cela demande bien sûr la volonté de quelques partis politiques et d’au moins 51 des 150 députés, pour partager ce jugement et éventuellement revoir leur position antérieure à ce sujet.
Encore mieux serait que le premier ministre, qui a déjà montré dans divers domaines son sens historique et sa capacité d’évolution, opère le revirement, renonce à l’abolition prévue et rétablisse le Sénat (SPQB) dans toutes ses compétences.